- JUDÉO-CHRISTIANISME
- JUDÉO-CHRISTIANISMELe terme de «judéo-christianisme » désigne des réalités d’une extension plus ou moins grande. On peut le réserver à l’Église de Jérusalem, composée de chrétiens de la circoncision et gouvernée par les parents de Jésus: c’est ce que fait H. J. Schoeps quand il en limite l’emploi aux ébionites dans lesquels il voit, de façon d’ailleurs contestable, les héritiers de l’Église de Jérusalem. Mais ce sens est trop étroit. Une seconde acception désigne par judéo-chrétiens des chrétiens fidèles aux observances juives: sabbat, circoncision, culte du Temple. Ce sens est tout à fait recevable. C’est celui qui convient aux adversaires de Paul. Ce judéo-christianisme est demeuré vivace jusque vers 140. Mais très tôt, le maintien des observances juives a été considéré comme incompatible avec la foi chrétienne, même en milieu sémitique. L’Épître de Barnabé , les Lettres d’Ignace d’Antioche, les écrits de Justin ne sont pas dirigés seulement contre les juifs, mais contre les chrétiens judaïsants. En fait, ce judéo-christianisme observant persista longtemps dans des petits groupes, comme l’a montré Marcel Simon, mais fut très vite marginal par rapport à l’Église.Reste une dernière perspective, qui n’exclut pas les autres, mais les déborde. Elle consiste à appeler judéo-christianisme un christianisme dont les structures théologiques, liturgiques, ascétiques sont empruntées au milieu juif à l’intérieur duquel est apparu le christianisme. En ce sens (et selon le critère adopté par J. Daniélou dans la Théologie du judéo-christianisme ), il y a eu des judéo-chrétiens qui rejetaient les observances. Ce judéo-christianisme se rencontre principalement, mais non exclusivement, dans le christianisme oriental de langue araméenne (Syrie, Mésopotamie, Transjordanie, Arabie).Une littérature apocalyptiqueOn possède aujourd’hui un nombre suffisant d’ouvrages judéo-chrétiens, orthodoxes ou hétérodoxes, pour se faire une idée de ce que fut la culture judéo-chrétienne. Il s’agit parfois de remaniements chrétiens d’écrits juifs, comme les Testaments des douze patriarches , ou de fragments exégétiques conservés en particulier dans l’Épître de Barnabé , et qui relèvent des méthodes de l’exégèse rabbinique, ou encore d’hymnes, comme les Odes de Salomon , apparentés aux Hodayoth de Qumr n, d’apocalypses comme l’Apocalypse de Pierre ou celle de Jacques . Certains de ces ouvrages sont composites: l’Ascension d’Isaïe comprend un martyre, une apocalypse, des visions; l’Épître des onze apôtres contient un testament, une catéchèse, une apocalypse; l’Épître de Barnabé un traité d’exégèse et une catéchèse morale; le Pasteur d’Hermas des visions, une catéchèse morale, une apocalypse. Certains ouvrages relèvent de genres littéraires chrétiens (évangiles, actes, épîtres), mais d’un caractère juif plus prononcé.Si l’on veut caractériser la culture judéo-chrétienne, on peut dire qu’elle relève essentiellement de l’apocalypse. L’apocalypse n’est pas seulement un genre littéraire, elle imprègne toute la pensée. On la retrouve en particulier dans l’exégèse du début de la Genèse. L’apocalyptique est essentiellement une révélation des secrets du monde céleste, de ses habitats et de ses habitants. L’angélologie y tient une place considérable. Elle est en ce sens une gnose, avec le caractère ésotérique qu’implique ce mot. Il y a une gnose juive, chez les sadocites en particulier; il y a une gnose judéo-chrétienne, dont le gnosticisme est la forme hétérodoxe. Par ailleurs, l’apocalyptique est une théologie de l’histoire: elle comporte un prédestinatianisme rigoureux où les événements sont inscrits de tout temps sur les livres célestes et peuvent être ainsi connus à l’avance par les visionnaires. Cette vision porte sur la totalité de l’histoire, l’accent étant mis toutefois sur l’eschatologie.La théologie judéo-chrétienneC’est dans le cadre apocalyptique, qui lui est commun avec le judaïsme du temps, que s’inscrit la théologie judéo-chrétienne. Le mystère de la Trinité est exprimé dans des catégories empruntées à l’angélologie; l’Incarnation est présentée comme la descente cachée du Bien-Aimé à travers les sept cieux et leurs anges; la descente aux enfers, l’ascension décrivent le mystère du Salut en référence à la cosmologie sacrée; la croix est par sa matière un signe de puissance, sceptre ou verge, et par sa forme un symbole de l’extension cosmique de l’action du Christ; l’Église est, comme déjà dans l’Épître aux Éphésiens et dans l’Apocalypse, préexistante dans la pensée de Dieu; enfin, un règne terrestre du Christ, d’une durée de mille ans, précède le Jugement et la Terre nouvelle.La structure de l’Église présente aussi des traits particuliers. Une Église locale est gouvernée par un collège de douze presbytres, dont l’un a la prééminence. Cela est attesté par les écrits clémentins et supposé par les Lettres d’Ignace d’Antioche, qui compare les presbytres au sénat des Apôtres. L’Église d’Égypte paraît avoir gardé longtemps cette structure. L’initiation comporte trois degrés: baptême de feu ou exorcisme; baptême d’eau; baptême d’Esprit-Saint avec l’onction et le couronnement. Les rites concernant les mourants se sont développés comme en témoignent les lamelles trouvées dans les ossuaires. La mort et la résurrection du Christ sont commémorées le 14 nizan, jour de la Pâque juive, ce qui constitue l’usage quartodéciman. Enfin, on remarquera les tendances ascétiques de l’Église judéo-chrétienne, particulièrement en Syrie, où les ascètes et les vierges occupent dans la communauté un rang privilégié.La carence d’expression judaïque dans l’ÉgliseConstituant originellement toute l’Église, très puissant jusque vers 140, le judéo-christianisme est très vite éclipsé par le christianisme paulinien. Il se trouve coupé de la grande Église, qui achève de se libérer de ses attaches juives. Les judéo-chrétiens sont considérés à partir de la fin du IIe siècle comme des hérétiques. C’est eux qu’on retrouve sous les désignations d’ébionites, de quartodécimans, d’encratites, de millénaristes, ou plus généralement de judaïsants. Coupés de la grande Église, ils dépérissent très vite en Occident. Mais on suit leurs traces du IIIe au IVe siècle en Orient, surtout en Palestine, en Arabie, en Transjordanie, en Syrie, en Mésopotamie. Certains sont absorbés par l’Islam, qui en est pour une part l’héritier; d’autres se rallient à l’orthodoxie de la grande Église tout en restant de culture sémitique, et les Églises d’Éthiopie, de Syrie et de Chaldée conservent des vestiges de judéo-christianisme.Reste une dernière question. Le judéo-christianisme a-t-il un avenir? Paul a profondément vu que se dégager de sa gangue juive était la condition pour que le christianisme réalise son universalité. Il serait autrement resté une secte juive. Mais la question se pose à notre époque inversement: le christianisme ayant maintenant acquis cette universalité, le problème est précisément la carence de son expression judaïque, comme l’un des aspects de cette universalité. Ici encore la dialectique de Paul apparaît prophétique. Dès lors que la bonne nouvelle a été annoncée aux Nations, la possibilité d’une branche judéo-chrétienne de l’Église se pose à nouveau. Rien n’empêche la constitution de communautés chrétiennes composées de juifs convertis et dont l’hébreu serait la langue liturgique. Rien n’empêche que des juifs circoncis puissent professer la foi au Christ, puisque cela a bien été la condition des Apôtres. De telles perspectives ouvertes montrent que le problème posé n’a pas seulement valeur historique, mais reste une réalité présente.
judéo-christianisme [ ʒydeokristjanism ] n. m.• 1867; de judéo- et christianisme♦ Ensemble des dogmes et préceptes communs au judaïsme et au christianisme.♢ Doctrine de certains chrétiens du Ier siècle selon laquelle l'initiation au judaïsme était indispensable aux chrétiens.
● judéo-christianisme nom masculin singulier Doctrine professée par les chrétiens d'origine juive, sur la nécessité de la pratique des observances mosaïques dans l'Église primitive. Ensemble des éléments constitutifs de la civilisation judéo-chrétienne, qui a modelé les sociétés occidentales.⇒JUDÉO-CHRISTIANISME, subst. masc.A. — Ensemble des religions juive et chrétienne, des croyances et des préceptes qui leur sont communs. C'est l'honneur du judéo-christianisme d'avoir donné une voix au pauvre (RENAN, Hist. peuple Isr., t. 5, 1892, p. 412). Et de ce fait que les mœurs changent, les religions qui durent longtemps, comme le judéo-christianisme, varient en morale (FRANCE, Révolte anges, 1914, p. 309).B. — En partic. Doctrine des débuts du christianisme, selon laquelle l'accès à celui-ci passe par l'initiation au judaïsme. (Dict. XIXe et XXe s.).Prononc. : [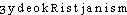 ]. Étymol. et Hist. 1867 (LITTRÉ). Composé de judéo- et de christianisme.judéo-christianisme [ʒydeokʀistjanism] n. m.❖♦ Didactique.1 Ensemble des dogmes et préceptes communs au judaïsme et au christianisme.0 Toutes les connexions (…) du judéo-christianisme avec le mithriacisme ou les religions iraniennes, avec les innombrables cultes morts, ne font pourtant qu'épaissir ce mystère (…)F. Mauriac, Bloc-notes 1952-1957, p. 16.2 Doctrine de certains chrétiens du premier siècle selon laquelle l'initiation au judaïsme était indispensable aux chrétiens.
]. Étymol. et Hist. 1867 (LITTRÉ). Composé de judéo- et de christianisme.judéo-christianisme [ʒydeokʀistjanism] n. m.❖♦ Didactique.1 Ensemble des dogmes et préceptes communs au judaïsme et au christianisme.0 Toutes les connexions (…) du judéo-christianisme avec le mithriacisme ou les religions iraniennes, avec les innombrables cultes morts, ne font pourtant qu'épaissir ce mystère (…)F. Mauriac, Bloc-notes 1952-1957, p. 16.2 Doctrine de certains chrétiens du premier siècle selon laquelle l'initiation au judaïsme était indispensable aux chrétiens.
Encyclopédie Universelle. 2012.
